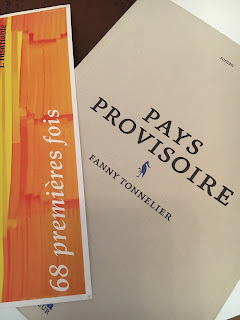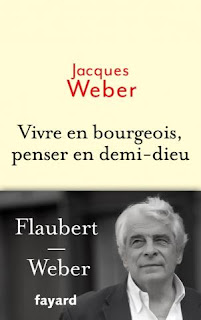Un autre roman prêté par Nombre Premier il y a un bail, voici L'élimination, qui propose une expérience de lecture douloureuse mais instructive.
Libres pensées...
Rithy Panh a survécu au génocide perpétré par les Khmers rouges alors qu'il était adolescent, qui a frappé sa famille et près de 2 millions d'hommes, femmes et enfants. Trente ans plus tard, il est devenu un homme, il a émigré, se dit en paix avec lui-même, et se retrouve confronté à Duch, responsable du centre S21 à Phnom Penh entre 1975 et 1979, où 12 000 personnes au moins furent torturées. Alors qu'il s'efforce de mettre Duch face à ses contradictions et à ses mensonges, dans le but de lui extorquer la vérité sur sa responsabilité et ainsi le rapprocher des hommes, Rithy Panh est replongé dans l'enfer qu'il a traversé, les souvenirs de sa famille, les témoignages et preuves accumulées contre les Khmers rouges, et face auxquels Duch persiste à nier son implication.
L'élimination est un récit extrêmement dur et éprouvant.
L'auteur n'épargne rien de son chemin de croix : les souvenirs qu'il a de la période décrite sont passés au crible, et ce qu'il garde de ses proches disparus le plus souvent dans des conditions insoutenables, eux qui appartenaient à la classe des "nouveaux hommes", semblable à une sorte de bourgeoisie, et cristallisant pour cela la volonté d'éradication du régime. Le récit est ainsi entrecoupé, jalonné de ces scènes très visuelles et d'une grande cruauté, avant de revenir à sa confrontation avec Duch, avec le silence de ce dernier, ses approximations, ses mensonges éhontés. Le narrateur s'emploie à faire la lumière sur les événements que Duch balaye d'un revers de main, alléguant qu'il n'a jamais participé à tout cela, que ce n'était pas lui, qu'il ignorait ces déviations, et, presque, que tout cela est un complot contre lui.
Face à lui, le narrateur campe un homme qui croyait avoir fait ses deuils, et que ce documentaire fait soudain resurgir, car depuis des années il s'est employé à faire connaître au monde les horreurs commises par les Khmers rouges, comme la torture de Bophana, cette jeune femme dont la faute était d'avoir écrit des lettres d'amour passionnées à son mari.
Les scènes de morts quotidiennes sont bien entendu effroyables ; je retiendrai en outre cette peur diffuse, la délation devenue monnaie courante, et ces arguments qui ont constitué l'idéologie instaurée par les Khmers : ne rien cacher, faire son autocritique, toujours faire prévaloir le bien de tous sur son intérêt minuscule, et le fait que cela ne s'applique qu'aux faibles, car c'est là bien sûr que l'on voit en quoi il s'agit bien d'une idéologie, faite pour contrôler et asservir les foules : certains ont toujours des passe-droits, ont accès aux réserves de nourriture, échappent à la misère et à la famine dont meurent des familles entières.
L'élimination est un récit foudroyant, qui apprend beaucoup sur les actes perpétrés par les Khmers rouges, leur idéologie, ce que la population a enduré, et la difficulté à faire entrer la vérité dans l'Histoire, face au silence des oppresseurs tombés.
Pour vous si...
- Vous connaissez mal la dictature des Khmers rouges, et l'impact qu'elle a eu sur le Cambodge.
- Vous ne vous en remettez qu'aux histoires vraies.
Morceaux choisis
"Pour ma part, depuis que les Khmers rouges ont été chassés du pouvoir, en 1979, je n'ai pas cessé de penser à ma famille. Je vois mes soeurs, mon grand frère et sa guitare, mon beau-frère, mes parents. Tous morts. Leurs visages sont des talismans. Je vois encore mes neveux et ma nièce, affamés, quel âge ont-ils, cinq et sept ans, ils respirent mal, regardent dans le vague, halètent. Je me souviens des derniers jours, du corps qui sait. Je me souviens de l'impuissance. Des lèvres d'enfants closes. Duch a semblé surpris par ma question [ndlr : "Un homme qui a dirigé un lieu comme S21 ne voit-il pas dans ses cauchemars les visages suppliciés qui l'appellent et lui demandent pourquoi ?"]. Il a réfléchi, et m'a simplement dit : "Des rêves ? Non. Jamais."
"Les livres affirment que Phnom Penh a fêté joyeusement l'arrivée des révolutionnaires. Je me souviens plutôt d'une fébrilité, d'une inquiétude, d'une sorte d'angoisse face à l'inconnu. Et je n'ai pas le souvenir de scènes de fraternisation. Ce qui nous a surpris, c'est que les révolutionnaires ne souriaient pas. Ils nous maintenaient à distance, avec froideur. Très vite, j'ai croisé leurs regards, j'ai vu les mâchoires serrées, les mains sur les détentes. J'ai été effrayé par cette première rencontre, et par l'absence totale d'âme."
"La question aujourd'hui n'est pas de savoir s'il [Duch] est humain ou non. Il est humain à chaque instant : c'est pourquoi il peut être jugé et condamné. On ne doit s'autoriser à humaniser ni à déshumaniser personne."
"Bien sûr, je dresse un portrait idéalisé de mon père, tant il m'a impressionné par sa force morale face aux Khmers rouges. Dans nos sociétés démocratiques, l'homme qui croit à la démocratie nous semble ordinaire. Voire ennuyeux. Aussi, dans mon bureau parisien, je garde devant moi son portrait un peu jauni : qu'il y ait une puissante banalité du bien. Ce sera sa victoire."
Note finale
4/5
(effroyable)